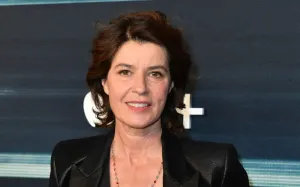Bothayna Alessa écrit depuis un lieu où la parole n’est jamais évidente. Un lieu antérieur au discours, proche de l’enfance, du manque et du vertige. Là où écrire ne consiste pas à dire, mais à supporter ce qui insiste. Ses textes portent la trace de cette origine : une écriture qui ne cherche pas la lumière, mais accepte de rester longtemps dans la pénombre, jusqu’à ce que quelque chose consente à apparaître
Lire Bothayna Alessa, ce n’est pas suivre une intrigue ; c’est entrer dans un climat. Un climat où la fragilité n’est jamais décorative, où la douceur n’est pas synonyme d’innocence, et où chaque geste narratif semble porter une charge morale discrète mais persistante. Ses textes ne s’imposent pas par la force. Ils s’installent. Ils travaillent le lecteur de l’intérieur, longtemps après la dernière page.
Ce qui frappe d’emblée dans son univers, c’est la centralité de l’enfance. Non pas l’enfance comme âge idéalisé, mais comme lieu de fracture originelle : là où s’apprennent la peur, l’obéissance, la curiosité, la honte, le désir de savoir. Chez elle, l’enfant n’est jamais un symbole. Il est une conscience en formation, déjà traversée par les lignes de force du monde adulte. L’école, la famille, la langue, les livres, la censure : tout apparaît très tôt comme un réseau de contraintes que l’enfant perçoit avant même de pouvoir les nommer.
Cette attention à l’enfance n’est pas nostalgique. Elle relève presque d’une démarche spirituelle. L’enfance, chez Bothayna Alessa, est le lieu où se joue la première relation au savoir : accepter, refuser, interroger, se taire. C’est aussi le lieu où se décide la possibilité future de la liberté intérieure. En ce sens, son écriture ne raconte pas seulement des histoires ; elle interroge la genèse de la conscience.
Il y a dans ses textes une dimension que l’on pourrait qualifier de soufie, non pas au sens doctrinal, mais au sens existentiel. Une manière de considérer l’écriture comme un exercice de dépouillement. Les phrases sont sobres, parfois presque retenues, comme si elles refusaient l’emphase. Cette économie n’est jamais une sécheresse ; elle est une ascèse. Écrire moins pour entendre davantage. Dire moins pour laisser résonner ce qui ne peut être formulé directement.
La relation au livre occupe, dans son œuvre, une place presque sacrée. Le livre y apparaît comme un objet dangereux et salvateur à la fois. Dangereux parce qu’il ouvre des brèches dans l’ordre établi. Salvateur parce qu’il offre une possibilité de refuge, de déplacement intérieur, de respiration. Cette ambivalence traverse tout son travail : le savoir n’est jamais présenté comme une conquête triomphante, mais comme une traversée risquée, parfois douloureuse, toujours transformatrice.
Bothayna Alessa n’écrit pas contre la société, mais depuis ses zones de tension. Elle observe les mécanismes de contrôle, de normalisation, de silence, sans les caricaturer. Ce qui l’intéresse n’est pas la dénonciation frontale, mais la manière dont ces mécanismes s’inscrivent dans les corps, dans les gestes quotidiens, dans les peurs ordinaires. Sa critique est lente, patiente, presque souterraine. Elle agit par accumulation plutôt que par choc.
Son rapport à la langue participe de cette même logique. La langue n’est pas chez elle un espace de virtuosité, mais un lieu de responsabilité. Chaque mot semble pesé, non pour sa beauté, mais pour sa justesse. Cette justesse crée une proximité singulière avec le lecteur : on ne se sent jamais dominé par le texte, mais accompagné. L’écriture ne surplombe pas ; elle marche à côté.
Cette posture se prolonge naturellement dans son engagement éditorial et culturel. Fonder, publier, accompagner des livres relève chez elle du même geste que l’écriture : créer des espaces où la pensée peut circuler sans être immédiatement jugée ou instrumentalisée. Là encore, pas de discours héroïque. Seulement un travail constant, presque invisible, au service de la transmission. Une manière de faire exister la culture non comme un monument, mais comme une pratique quotidienne.
Ce qui distingue profondément Bothayna Alessa dans le paysage littéraire contemporain, c’est cette capacité à tenir ensemble la vulnérabilité et la rigueur. Ses textes sont sensibles, mais jamais complaisants. Ils accueillent la fragilité sans la romantiser. Ils reconnaissent la peur sans la transformer en posture. Cette éthique du regard confère à son œuvre une rare crédibilité morale.
Dans un monde saturé de récits rapides, de prises de position immédiates et de discours définitifs, son travail propose autre chose : une lenteur habitée. Une invitation à relire, à douter, à revenir sur ses propres certitudes. Lire Bothayna Alessa, c’est accepter de ne pas comprendre tout de suite. C’est accepter que certaines questions restent ouvertes, que certaines blessures ne se referment pas, et que cette ouverture même constitue une forme de vérité.
Son écriture ne promet ni guérison ni rédemption. Elle propose un compagnonnage. Une présence discrète, mais fidèle, pour celles et ceux qui cherchent dans la littérature non pas des réponses, mais une manière plus juste d’habiter leurs questions. En cela, son œuvre dépasse largement le cadre du roman ou de l’essai : elle devient une pratique intérieure.
Il serait tentant de qualifier Bothayna Alessa d’« engagée ». Le terme serait réducteur. Son engagement n’est pas dans le slogan, mais dans la constance. Dans le refus de céder à la facilité. Dans la fidélité à une vision exigeante de la lecture et de l’écriture. Elle ne cherche pas à changer le monde par le bruit, mais par la persistance.
Ainsi, lire ses livres, c’est entrer dans une forme de veille. Une veille de l’esprit, de la mémoire, de l’enfance que nous portons encore, parfois à notre insu. Une veille silencieuse, presque méditative, qui rappelle que la littérature, lorsqu’elle est habitée avec sincérité, demeure l’un des rares lieux où l’âme peut encore respirer sans se justifier.
Ali Al-Hussien
Paris