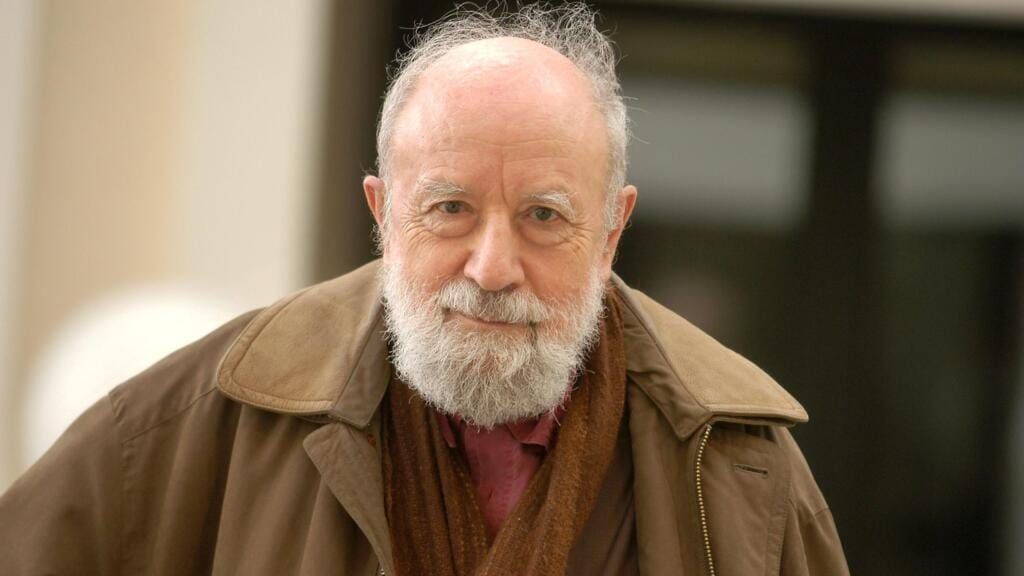Lorsque Michel Butor arrive en Égypte, il n’est encore qu’un jeune homme de vingt-cinq ans. Nous sommes au début des années 1950. Rien ne laisse alors présager que ce séjour, limité à quelques mois, deviendra l’un des socles sensibles de son rapport au monde, au langage et à l’espace. Il est envoyé à Minya pour enseigner le français, dans le cadre d’un programme mis en place par le ministère égyptien de l’Instruction publique, dirigé à l’époque par Taha Hussein, figure majeure de la pensée arabe moderne.
L’Égypte n’est pas pour Butor une simple destination professionnelle. Elle s’impose d’emblée comme une expérience fondatrice. Des années plus tard, il y reviendra par l’écriture, dans un texte intitulé Égypte, publié dans Génie du lieu, ouvrage où il explore la manière dont certains territoires façonnent durablement la perception et la pensée. Loin du carnet de voyage, ce texte relève d’une méditation profonde sur la relation entre l’homme, l’histoire et la géographie.
Butor décrit l’Égypte comme une seconde naissance. Non pas une renaissance idéalisée, mais une immersion lente dans un espace saturé de temps. Le pays lui apparaît comme un corps immense, nourri par le delta, traversé par les strates successives des civilisations, capable d’absorber et de transformer tout ce qui le traverse. Cette vision organique du territoire irrigue l’ensemble de son récit.
À son arrivée au Caire, il loge brièvement dans un hôtel modeste avant d’être affecté à Minya. La ville lui est présentée comme moderne, prospère, en pleine expansion. La réalité qu’il découvre est plus âpre. Il vit dans un appartement presque vide, réduit à l’essentiel, à l’image de ceux de ses collègues égyptiens. Cette précarité matérielle n’est pas décrite avec misérabilisme, mais comme un état de fait révélateur d’un mode de vie sobre, resserré autour de la nécessité.
Minya est alors une ville en formation, gagnée lentement sur la poussière. Autour, les champs de coton et de blé irriguent l’horizon, tandis que le désert, tout proche, impose sa présence silencieuse. Butor observe les gestes quotidiens, les rythmes saisonniers, les corps au travail. Les femmes vêtues de coton clair, les jarres d’eau portées sur la tête, les enfants marqués par la maladie et la fatigue, les animaux, les chants nocturnes : tout compose un paysage humain où la beauté et la rudesse coexistent sans s’annuler.
Dans l’institut où il enseigne, Butor se heurte à l’impossibilité pédagogique. Les élèves ne maîtrisent pas le français. Très vite, la salle de classe devient un espace indiscipliné, parfois violent. Plutôt que d’imposer l’autorité par la force, il choisit l’observation et la retenue, refusant de faire appel à la répression policière omniprésente. Cette position, déjà, annonce une éthique du regard qui traversera toute son œuvre.
L’écrivain note également la complexité religieuse et sociale de la ville. Pratiques croyantes diverses, relâchement ou rigueur, coexistence tendue entre communautés, survivances de traditions anciennes : Minya apparaît comme un carrefour de temporalités plus que comme une ville figée dans une identité unique. Le printemps, avec ses fêtes populaires, révèle cette continuité entre les rites anciens et la vie contemporaine.
Certaines expériences nocturnes, vécues sur les rives du Nil, marquent profondément Butor. Le silence, la fraîcheur de l’air, les étoiles, les voix lointaines, les passages des policiers au tarbouche rouge, composent une atmosphère presque irréelle. Ces moments, loin d’être anecdotiques, participent de son apprentissage sensible du monde.
Le texte s’achève sur une visite aux pyramides, décrite non comme une découverte touristique, mais comme une révélation intérieure. À dos d’âne, dans la lumière déclinante, Butor éprouve la sensation obscure mais irrévocable qu’un pan du réel lui a été dévoilé. La fatigue du corps, la douleur légère, deviennent les preuves tangibles de cette connaissance acquise. Lorsque la nuit tombe sur le Nil, une question demeure, simple et vertigineuse : quand reviendra-t-il en Égypte ?
Ce séjour bref, presque accidentel, aura suffi à inscrire l’Égypte au cœur de la géographie intime de Michel Butor. Non comme un souvenir figé, mais comme un lieu matriciel, où le regard s’est formé, où l’écriture a appris à se confronter à la densité du monde.
Rédaction du Bureau du Caire