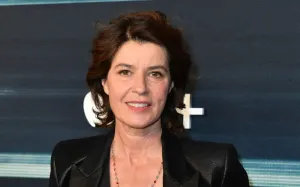Il existe des cinéastes qui abordent le réel comme un champ de bataille, et d’autres qui s’y avancent avec une forme plus silencieuse de détermination. Chez Nabil Ayouch, le cinéma ne se présente jamais comme un manifeste, encore moins comme une déclaration idéologique. Il procède plutôt d’un travail patient de tenue : tenir un cadre, tenir un rythme, tenir une distance juste entre ce qui est montré et ce qui demeure irréductiblement opaque. Cette posture, souvent mal comprise, constitue pourtant la clé la plus constante de son parcours.
Avant même de parler de films, il faut parler de méthode. Ayouch ne vient pas d’une tradition contemplative ou littéraire du cinéma. Il arrive à l’image par la fabrication, par la commande, par l’économie concrète du regard. Son passage par la publicité n’est pas un détour anecdotique ; il fonde une relation particulière à la caméra comme outil de décision. Là où d’autres cherchent d’abord le sens, lui construit d’abord un dispositif : qui regarde, depuis où, combien de temps, et à quelles conditions. Le cinéma, chez lui, commence par cette question très simple et très lourde : que permet-on à l’image de faire, et que lui refuse-t-on délibérément ?
Ce refus de l’emphase est central. Ayouch n’a jamais filmé pour convaincre. Il filme pour maintenir une tension. Ses plans ne cherchent ni l’adhésion ni la consolation. Ils organisent un espace où le spectateur est contraint de rester, sans être guidé, sans être rassuré. Cette économie du regard produit souvent un malaise, parfois une incompréhension, mais elle relève d’un choix profondément cohérent : ne pas transformer la complexité humaine en récit explicatif.
Très tôt, ses films se sont installés dans des zones que le cinéma préfère souvent contourner. Non par provocation, mais par fidélité à une intuition : certaines réalités ne peuvent être abordées que si l’on accepte de renoncer au confort narratif. Ayouch ne cherche pas à illustrer des thèmes, il cherche à capter des états. Ce sont des films où les corps précèdent les discours, où les gestes précèdent les intentions, où la parole arrive souvent trop tard. La caméra n’interprète pas ; elle observe jusqu’au point de rupture.
Cette approche explique son rapport particulier aux acteurs, souvent non professionnels. Le jeu, chez Ayouch, n’est jamais un exercice de performance. Il est une négociation constante entre présence et retenue. Il ne s’agit pas de faire dire quelque chose aux corps, mais de leur laisser le temps de se révéler dans leur propre résistance. Cette lenteur, cette patience, produisent une forme de vérité fragile, toujours menacée, jamais stabilisée. Le film devient alors un espace de passage, non un lieu de démonstration.
Mais réduire Ayouch à son geste de mise en scène serait insuffisant. Son travail se déploie tout autant dans l’architecture invisible de la production. Producteur autant que réalisateur, il occupe une position singulière dans le paysage cinématographique : celle d’un médiateur entre des réalités sociales complexes et des structures institutionnelles exigeantes. Cette double fonction l’oblige à penser le cinéma non seulement comme un art, mais comme une responsabilité. Responsabilité envers les personnes filmées, envers les équipes, envers les spectateurs, et envers un écosystème fragile où chaque film engage bien plus que sa seule réception critique.
C’est dans cette dimension que son parcours prend toute sa profondeur. Ayouch ne cherche pas à opposer le local à l’international. Il travaille précisément dans l’intervalle. Ses films ne sont jamais conçus comme des objets d’exportation culturelle, mais comme des formes suffisamment rigoureuses pour traverser les frontières sans se trahir. Cette exigence explique leur présence régulière dans les grands festivals : non comme des curiosités exotiques, mais comme des propositions cinématographiques pleinement assumées.
Ce positionnement intermédiaire est souvent inconfortable. Il expose à des malentendus, à des lectures réductrices, à des projections idéologiques qui ne lui appartiennent pas. Pourtant, Ayouch persiste dans cette ligne étroite. Il ne corrige pas ses films pour les rendre acceptables, pas plus qu’il ne les radicalise pour en accentuer l’impact. Il maintient le cap, convaincu que le cinéma ne gagne rien à céder aux simplifications, qu’elles soient morales, politiques ou esthétiques.
Son rapport au réel est à ce titre profondément non spectaculaire. Là où le spectaculaire cherche l’effet immédiat, Ayouch construit des temporalités longues, parfois éprouvantes. Le montage n’accélère pas pour séduire ; il ralentit pour laisser advenir. Cette lenteur n’est pas un choix formel gratuit. Elle correspond à une éthique : celle de ne pas voler aux personnages le temps nécessaire à leur propre complexité.
Dans un paysage médiatique saturé d’images commentées, expliquées, surinterprétées, cette retenue fait figure de résistance. Ayouch ne parle pas à la place de ses films. Il accepte qu’ils soient traversés de contradictions, de zones aveugles, d’ambiguïtés irréductibles. Cette acceptation du non-résolu est sans doute l’un des aspects les plus exigeants de son travail. Elle suppose une confiance rare dans l’intelligence du spectateur, mais aussi une forme de renoncement personnel : renoncer à maîtriser entièrement le sens.
Au fil des années, cette cohérence a dessiné une œuvre identifiable sans jamais devenir répétitive. Chaque film semble reprendre les mêmes questions sous des angles légèrement déplacés, comme si le cinéma, pour Ayouch, était moins un chemin linéaire qu’un cercle élargi, revenant sans cesse autour de quelques points essentiels : la dignité, la vulnérabilité, la manière dont les individus habitent des structures qui les dépassent.
Ce qui frappe, en définitive, n’est pas la radicalité de ses sujets, mais la constance de son regard. Ayouch ne filme pas contre, ni pour. Il filme avec une attention presque obstinée à ce qui résiste à la mise en récit. Dans cette obstination réside peut-être la dimension la plus politique de son travail, au sens le plus noble du terme : refuser les réponses toutes faites, maintenir ouvert l’espace du regard, et accepter que le cinéma soit avant tout un lieu d’inconfort fécond.
Dans un monde où l’image est souvent sommée de prendre position, de trancher, de simplifier, le cinéma de Nabil Ayouch rappelle une autre possibilité : celle d’une image qui tient, sans se justifier, là où le langage se retire.
PO4OR – Bureau de Paris